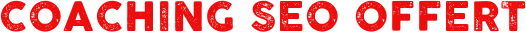Pour un moteur de recherche, atteindre l’équilibre financier sans nuire à la pertinence des résultats de recherche, une équation difficile à mettre en œuvre :
Le risque majeur pour Google, s’il existe, doit être perçu comme la prise en main, en interne, du pouvoir par les équipes commerciales et partant de là, de l’adéquation moins forte des résultats obtenus via Google par les internautes, au profit de résultats « sponsorisés ».
En effet, l’étude de l’histoire récente des moteurs de recherche sur Internet laisse présager un scénario analogue, dans de nombreux cas depuis la création de l’Internet : montée en puissance du dit moteur sous l’impulsion d’équipes de développement et d’un savoir-faire spécifique, suivie d’une prise en main de la structure du moteur de recherche par les équipes commerciales qui privilégient dans leurs pages de résultats les liens publicitaires et les résultats sponsorisés au détriment de sites Internet aux contenus plus pertinents.
Ce scénario, si souvent remarqué, provoque généralement à moyen terme la désertion et la baisse de fréquentation du moteur de recherche par les internautes dont l’indice de satisfaction par ledit moteur faiblit. Ce scénario s’est appliqué par exemple de manière formelle à Lycos et Altavista, outils de recherche majeurs encore en l’an 2000, à Hotbot et au moteur plus spécifiquement francophone Voila (groupe Wanadoo), dont les parts de marché – il y a encore un an de cela honorables avec plus de dix pour cent des requêtes effectuées en France – approchent maintenant du 1% fatidique.
Néanmoins, il faut souligner que les fondateurs de Google, dès 1998, semblent avoir bien identifié ce risque, bien réel. Bien que la publicité représente une part toujours plus grande du chiffre d’affaire du moteur de recherche, la structure des pages qui présentent les résultats des recherche du moteur – résultats au centre, publicité avec les Adwords bien identifiables pour l’internaute, en haut et sur la gauche, d’une couleur différente – permet une stricte séparation entre les « liens sponsorisés » et les résultats obtenus.
Ainsi, la « pollution » de la page de résultats – si souvent observée par ailleurs - par des liens publicitaires est évitée. Pop-up et bannières publicitaires ne sont pas des modèles publicitaires qui furent retenus lors de la mise en place des outils publicitaire par Google.
De la sorte, l’internaute est « informé » de manière simple et didactique sur la nature des liens sur lesquels il clique : liens publicitaires ou non. Cette clarté dans les pages de résultats présentés, la volonté de ne pas « forcer le clic » vers des liens publicitaires, permet à Google de ne pas perdre en crédibilité auprès des internautes. C’est là un élément clef, semble-t-il de la réussite du moteur de recherche.
Les cofondateurs, Lawrence Page et Sergey Brin, ont perçu dès le départ, en 1998, le risque de mêler dans un même espace graphique, sur une page de résultats du moteur de recherche, des résultats sponsorisés, de nature publicitaire, et les « vrais » résultats, obtenus sur la seule base d’algorithmes mathématique. Un tel mélange, même s’il est parfois organisé de manière subtile par certains moteurs de recherche , tend à décrédibiliser la pertinence du moteur de recherche auprès des consommateurs et à provoquer sa désaffection progressive.
D’ailleurs, aux dires d’Éric Schmidt, président de Google, les serveurs qui fournissent la publicité sur les pages de résultats sont strictement séparés de ceux qui fournissent les résultats .
Ainsi, le modèle de développement économique de Google, tel qu’il est respecté depuis le départ, paraît dès lors particulièrement pertinent dans l’économie de l’Internet et permet d’assurer la pérennité à moyen terme de la firme californienne.
Les observateurs ont souvent mis l’accent sur la réussite de l’architecture technique du moteur de recherche Google, notamment la qualité de ses algorithmes de recherche et la mise en place d’une vaste architecture de stockage des données, pour expliquer son succès.
Cette approche, bien qu’elle soit justifiée, ne paraît pas prendre en compte l’ensemble des paramètres disponibles pour l’étude.
En effet, la réussite de la firme californienne repose également sur le respect de certains fondamentaux dont l’abandon a si souvent provoqué la désaffection progressive de certains moteurs de recherche, francophones ou non : une séparation stricte entre les liens publicitaires et les résultats obtenus via les algorithmes de recherche.
De la sorte, le succès de la firme californienne paraît ainsi tout à la fois technique et commercial.
Les compagnies qui voudraient concurrencer un jour Google doivent certainement intégrer ces fondamentaux, si elles veulent apparaître un jour en tant qu’alternative crédible pour les internautes.
Joël Faucilhon
Le risque majeur pour Google, s’il existe, doit être perçu comme la prise en main, en interne, du pouvoir par les équipes commerciales et partant de là, de l’adéquation moins forte des résultats obtenus via Google par les internautes, au profit de résultats « sponsorisés ».
En effet, l’étude de l’histoire récente des moteurs de recherche sur Internet laisse présager un scénario analogue, dans de nombreux cas depuis la création de l’Internet : montée en puissance du dit moteur sous l’impulsion d’équipes de développement et d’un savoir-faire spécifique, suivie d’une prise en main de la structure du moteur de recherche par les équipes commerciales qui privilégient dans leurs pages de résultats les liens publicitaires et les résultats sponsorisés au détriment de sites Internet aux contenus plus pertinents.
Ce scénario, si souvent remarqué, provoque généralement à moyen terme la désertion et la baisse de fréquentation du moteur de recherche par les internautes dont l’indice de satisfaction par ledit moteur faiblit. Ce scénario s’est appliqué par exemple de manière formelle à Lycos et Altavista, outils de recherche majeurs encore en l’an 2000, à Hotbot et au moteur plus spécifiquement francophone Voila (groupe Wanadoo), dont les parts de marché – il y a encore un an de cela honorables avec plus de dix pour cent des requêtes effectuées en France – approchent maintenant du 1% fatidique.
Néanmoins, il faut souligner que les fondateurs de Google, dès 1998, semblent avoir bien identifié ce risque, bien réel. Bien que la publicité représente une part toujours plus grande du chiffre d’affaire du moteur de recherche, la structure des pages qui présentent les résultats des recherche du moteur – résultats au centre, publicité avec les Adwords bien identifiables pour l’internaute, en haut et sur la gauche, d’une couleur différente – permet une stricte séparation entre les « liens sponsorisés » et les résultats obtenus.
Ainsi, la « pollution » de la page de résultats – si souvent observée par ailleurs - par des liens publicitaires est évitée. Pop-up et bannières publicitaires ne sont pas des modèles publicitaires qui furent retenus lors de la mise en place des outils publicitaire par Google.
De la sorte, l’internaute est « informé » de manière simple et didactique sur la nature des liens sur lesquels il clique : liens publicitaires ou non. Cette clarté dans les pages de résultats présentés, la volonté de ne pas « forcer le clic » vers des liens publicitaires, permet à Google de ne pas perdre en crédibilité auprès des internautes. C’est là un élément clef, semble-t-il de la réussite du moteur de recherche.
Les cofondateurs, Lawrence Page et Sergey Brin, ont perçu dès le départ, en 1998, le risque de mêler dans un même espace graphique, sur une page de résultats du moteur de recherche, des résultats sponsorisés, de nature publicitaire, et les « vrais » résultats, obtenus sur la seule base d’algorithmes mathématique. Un tel mélange, même s’il est parfois organisé de manière subtile par certains moteurs de recherche , tend à décrédibiliser la pertinence du moteur de recherche auprès des consommateurs et à provoquer sa désaffection progressive.
D’ailleurs, aux dires d’Éric Schmidt, président de Google, les serveurs qui fournissent la publicité sur les pages de résultats sont strictement séparés de ceux qui fournissent les résultats .
Ainsi, le modèle de développement économique de Google, tel qu’il est respecté depuis le départ, paraît dès lors particulièrement pertinent dans l’économie de l’Internet et permet d’assurer la pérennité à moyen terme de la firme californienne.
Les observateurs ont souvent mis l’accent sur la réussite de l’architecture technique du moteur de recherche Google, notamment la qualité de ses algorithmes de recherche et la mise en place d’une vaste architecture de stockage des données, pour expliquer son succès.
Cette approche, bien qu’elle soit justifiée, ne paraît pas prendre en compte l’ensemble des paramètres disponibles pour l’étude.
En effet, la réussite de la firme californienne repose également sur le respect de certains fondamentaux dont l’abandon a si souvent provoqué la désaffection progressive de certains moteurs de recherche, francophones ou non : une séparation stricte entre les liens publicitaires et les résultats obtenus via les algorithmes de recherche.
De la sorte, le succès de la firme californienne paraît ainsi tout à la fois technique et commercial.
Les compagnies qui voudraient concurrencer un jour Google doivent certainement intégrer ces fondamentaux, si elles veulent apparaître un jour en tant qu’alternative crédible pour les internautes.
Joël Faucilhon